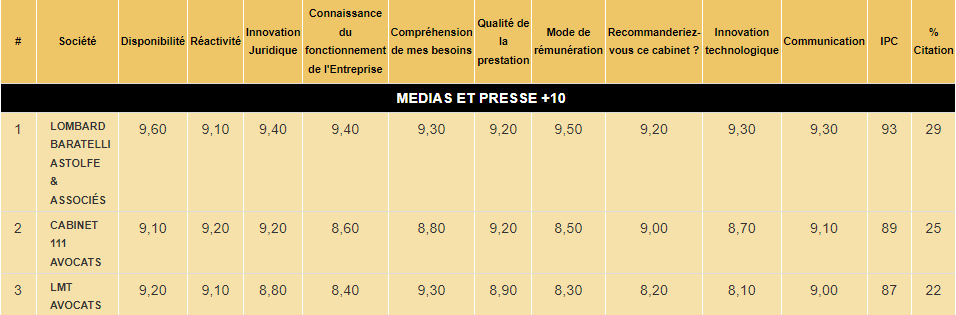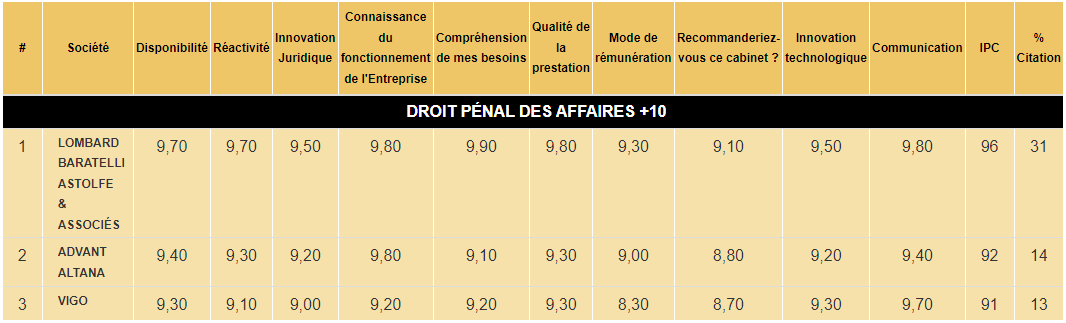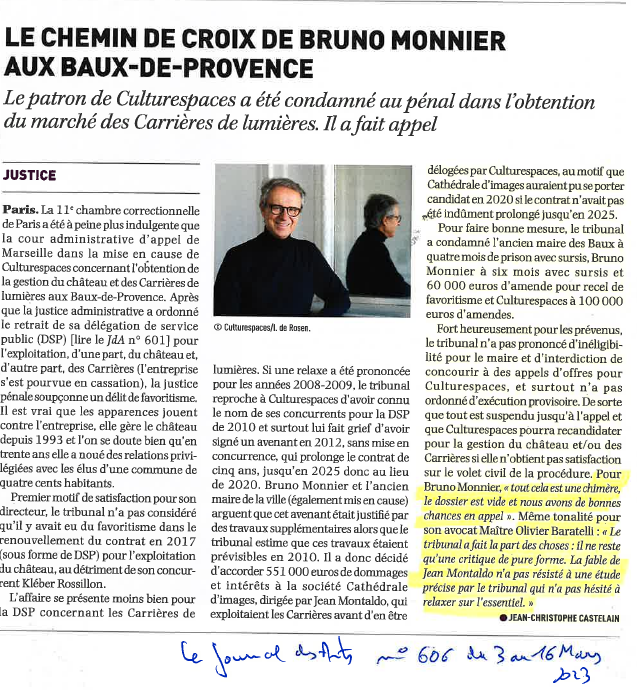Tout est une histoire d’équilibre.
Depuis 2008, la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) a cherché à atteindre cet équilibre, celui entre la protection de la liberté d’expression des lanceurs d’alerte et l’éventuelle sanction en raison du préjudice causé à l’employeur du fait de la divulgation d’informations confidentielles, recueillies sur leur lieu de travail.
L’exercice peut s’avérer difficile dès lors que l’employé est tenu, dans le cadre de sa relation de travail, à un devoir de loyauté, de réserve et de discrétion.
Pour déterminer si une sanction du lanceur d’alerte a causé une ingérence disproportionnée dans l’exercice de son droit à la liberté d’expression, la Cour a défini 6 critères dans l’arrêt Guja c. Moldavie du 12 février 2018[1] :
- l’existence ou non d’autres moyens pour procéder à la divulgation ;
- l’intérêt public présenté par les informations divulguées ;
- l’authenticité des informations divulguées ;
- le préjudice causé à l’employeur ;
- la bonne foi du lanceur d’alerte ;
- la sévérité de la sanction.
La Cour s’étant toujours refusée à donner une définition précise du lanceur d’alerte, c’est à un examen concret de chaque situation qu’elle se livre pour dire s’il y a eu ou non violation de l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Dans son arrêt de Grande Chambre du 14 février 2023[2], la Cour s’est prononcée sur le renvoi d’un arrêt de chambre du 11 mai 2021 qui avait conclu à une absence de violation de l’article 10 précité dans l’affaire dite « LuxLeaks », alors qu’un lanceur d’alerte avait été condamné en appel à 1.000 euros d’amende et au paiement d’un euro symbolique de dommages et intérêts, pour avoir divulgué « quatorze déclarations fiscales et deux courriers d’accompagnement » qui furent repris dans l’émission « Cash investigation » et « mis en ligne par une association regroupant des journalistes, dénommée « International Consortium of Investigative Journalists » (« ICIJ ») ».
Dans son arrêt de 2021, la Cour avait considéré que l’intérêt public de la divulgation n’était pas suffisant pour compenser le préjudice subi par l’employeur du lanceur d’alerte.
En Grande Chambre, la Cour adopte une solution différente et conclut à une violation de l’article 10 de la Convention au motif, notamment, que les informations divulguées étaient bien de celles présentant un intérêt public[3] et, partant, susceptibles de justifier une alerte car « touchant au fonctionnement des autorités publiques dans une société démocratique et provoquant, dans le public, un débat suscitant des controverses (…) ».
« Quant à la mise en balance entre l’intérêt public que présente l’information divulguée et les effets dommageables de la divulgation », la CEDH précise, d’abord, que le contexte dans lequel s’opère la divulgation doit être apprécié. En l’espèce, les informations divulguées s’inscrivaient dans la continuité d’un débat public sur les pratiques fiscales au Luxembourg mais aussi dans le reste de l’Europe et, en particulier, en France. A cet égard, les juges de la Grande Chambre rappellent que :
« qu’un débat public peut s’inscrire dans la continuité et être nourri par des éléments d’informations complémentaires (Dammann, précité, § 54, et Colaço Mestre et SIC – Sociedade Independente de Comunicação, S.A. c. Portugal, nos 11182/03 et 11319/03, § 27, 26 avril 2007). Des révélations qui portent sur des faits d’actualité ou débats préexistants peuvent également servir l’intérêt général (Couderc et Hachette Filipacchi Associé, précité, § 114). En effet, un débat public n’est pas figé dans le temps et, ainsi que le fait valoir MLA[4], « l’attitude des citoyens sur des questions d’intérêt public est évolutive » (paragraphe 98 ci-dessus). Dès lors, pour la Cour, la seule circonstance qu’un débat public sur les pratiques fiscales au Luxembourg était déjà en cours au moment où le requérant divulgua les informations litigieuses ne saurait en soi exclure que ces informations puissent, elles-aussi, présenter un intérêt public au regard du débat ayant suscité des controverses en ce qui concerne les pratiques fiscales des sociétés en Europe, et en particulier en France (voir paragraphes 187 à 192 ci-dessous) et de l’intérêt légitime du public à en connaître. »
Ensuite, la Cour considère que l’appréciation des effets dommageables de la divulgation ne doit pas se faire au regard des seuls impacts financiers éventuels pour l’employeur ; lequel a subi un préjudice de réputation dont « la réalité n’apparaît pas avérée sur le long terme »[5]. La CEDH relève ainsi que, « sur le second plateau de la balance », la Cour d’appel ayant condamné le lanceur d’alerte :
« s’est contentée de placer le seul préjudice subi par PwC et a seulement tenu compte de la circonstance que l’employeur du requérant avait été « associé à une pratique d’évasion fiscale, sinon à une optimisation fiscale », qu’il avait été « victime d’infractions pénales » et avait « subi nécessairement un préjudice » (paragraphe 35 ci-dessus).
200. Certes, aux yeux de la Cour, les éléments d’appréciation retenus par la Cour d’appel en ce qui concerne le préjudice subi par PwC, à savoir « l’atteinte à l’image » et « une perte de confiance » (paragraphe 35 ci-dessus), sont incontestablement pertinents. Pour autant, la Cour d’appel s’est contentée de les formuler en termes généraux, sans apporter de précision permettant de comprendre pourquoi elle a finalement estimé qu’un tel préjudice, dont la nature et la portée n’ont au demeurant pas été déterminées de manière circonstanciée, était « supérieur à l’intérêt général » que présentait la divulgation des informations litigieuses. La Cour en déduit que la Cour d’appel n’a pas placé, dans le second plateau de la balance, l’ensemble des effets dommageables qu’il convenait de prendre en compte.»
Il est donc revenu à la Grande Chambre de procéder « elle-même à la mise en balance des intérêts en présence » ; laquelle lui a permis de conclure que l’intérêt public « attaché à la divulgation », dans le cas d’espèce, l’emporte sur « l’ensemble des effets dommageables » :
« À cet égard, elle rappelle qu’elle a reconnu que les informations révélées par le requérant présentaient indéniablement un intérêt public (paragraphes 191-192 ci-dessus). Dans le même temps, elle ne saurait ignorer que la divulgation litigieuse s’est faite au prix d’un vol de données et de la violation du secret professionnel qui liait le requérant. Ceci étant, elle relève l’importance relative des informations divulguées, eu égard à leur nature et à la portée du risque s’attachant à leur révélation. Au vu des constats opérés ci-dessus (paragraphes 191-192 ci- dessus) quant à l’importance, à l’échelle tant nationale qu’européenne, du débat public sur les pratiques fiscales des multinationales auquel les informations divulguées par le requérant ont apporté une contribution essentielle, la Cour estime que l’intérêt public attaché à la divulgation de ces informations, l’emporte sur l’ensemble des effets dommageables. »
Enfin, sans revenir sur l’intégralité des 6 critères précités – lesquels étaient satisfaits en l’espèce – , il est important de signaler la précision apportée par la Cour au premier d’entre eux, à savoir le critère de « l’existence ou non d’autres moyens pour procéder à la divulgation ».
En effet, si la voie interne (saisie de sa hiérarchie par le lanceur d’alerte) doit être privilégiée à la voie externe, la Cour rappelle que « cet ordre de priorité entre canaux internes et canaux externes de signalement ne revêt pas, dans la jurisprudence de la Cour, un caractère absolu. ».
Concrètement, cela signifie qu’il peut exister des situations dans lesquelles les « mécanismes internes de signalement » ne sont pas adaptés ; ce qui peut justifier le « recours direct à une « voie externe de dénonciation » ».
Tel était ici le cas dès lors que « les pratiques d’optimisation fiscale au bénéfice de grandes multinationales et les déclarations fiscales – actes juridiques d’information (paragraphe 28 ci-dessus) préparées par l’employeur du requérant pour le compte de ses clients, à destination des services fiscaux luxembourgeois, étaient légales au Luxembourg » et que, partant, « Elles ne révélaient donc rien de répréhensible, au sens de la loi, qui aurait justifié que le requérant tente d’alerter sa hiérarchie afin qu’il fût mis un terme à des agissements constituant l’activité normale de son employeur ».
Il est donc particulièrement important de relever que, ce faisant, la CEDH conforte la protection de la liberté d’expression des lanceurs d’alerte ; lesquels, lorsque les pratiques révélées sont légales, ne peuvent divulguer des informations d’intérêt public que par la voie d’un canal externe :
« La Cour considère que, dans pareil cas, seul le recours direct à un canal externe de divulgation est susceptible de constituer un moyen efficace d’alerte. Ainsi que le fait valoir MLA, dans certaines circonstances, le recours aux médias peut s’avérer être la condition de l’efficacité du lancement d’alerte (paragraphe 97 ci-dessus). Dans ces conditions, lorsque sont en cause des agissements ou des pratiques portant sur les activités habituelles de l’employeur et qui n’ont, en soi, rien d’illégal, le respect effectif du droit de communiquer des informations présentant un intérêt public suppose d’admettre le recours direct à une voie externe de divulgation, se traduisant, le cas échéant, par la saisine des médias. C’est d’ailleurs ce que la Cour d’appel a admis, en l’espèce, en jugeant que le requérant ne pouvait pas agir autrement, et qu’« une information du public par un média était, en l’occurrence, et vu les circonstances, la seule alternative réaliste pour lancer l’alerte » (paragraphe 34 ci-dessus). La Cour tient à souligner qu’un tel constat est cohérent avec sa jurisprudence. »
A la lecture de l’arrêt Halet c. Luxembourg, la protection des lanceurs d’alerte ressort incontestablement renforcée.
En effet, en insistant sur la « légitimité » d’une divulgation externe d’informations lorsque les comportements en cause sont légaux, d’une part, en précisant – ou en élargissement selon l’opinion dissidente commune annexée à la décision – le critère de l’intérêt public, d’autre part, la CEDH poursuit la construction d’une jurisprudence toujours plus protectrice des lanceurs d’alerte.
Au mépris de notions pourtant tout aussi précieuses dans une société démocratique telles que le secret professionnel ? La prise en compte par les juridictions nationales de la solution retenue par la Cour de Strasbourg et son articulation avec le régime juridique interne[6] de protection des lanceurs d’alerte seront à surveiller de près.
[1] CEDH, 12 février 2018, Guja c. Moldavie, n° 14277/04.
[2] CEDH, 14 février 2023, Halet c. Luxembourg, n° 21884/18.
[3] L’opinion dissidente de 4 des 17 juges composant la Grande Chambre, annexée à l’arrêt, évoque un « élargissement [considérable] de la « notion d’intérêt public » qui « doit être attaché à l’information divulguée pour pouvoir faire bénéficier le lanceur d’alerte d’une protection. ». Plus précisément, ces 4 juges considèrent qu’au « signalement par un employé des actes, des pratiques ou des comportements illicites, sur le lieu de travail » et « ceux qui sont qui sont répréhensibles tout en étant légaux », l’arrêt du 14 février 2023 y ajoute une troisième catégorie de comportements « entièrement nouvelle en matière de lancement d’alerte, à savoir « certaines informations touchant au fonctionnement des autorités publiques dans une société démocratique et provoquant, dans le public, un débat suscitant des controverses de nature à faire naître un intérêt légitime de celui-ci à en connaître, afin de se forger une opinion éclairée sur la question de savoir si elles révèlent ou non une atteintes à l’intérêt public » (paragraphe 138), tout en précisant que les informations peuvent aussi porter sur des comportements d’acteurs privés (paragraphe 142). ».
Les 4 magistrats dénoncent « un critère excessivement flou ». Il est vrai, comme ces derniers le soulignent, que, d’une part, « l’intérêt de la divulgation va décroissant selon que l’on se trouve dans la première, la deuxième ou la troisième catégorie », d’autre part, que s’agissant de la catégorie « nouvelle » selon eux du « débat suscitant des controverses », celle-ci met à mal les notions de secret professionnel et de confidentialité. C’est la raison pour laquelle, afin de ne pas créer davantage d’insécurité juridique, la solution retenue ici par la Cour, et qualifiée dans l’opinion dissidente commune de « revirement de jurisprudence », devrait voir ses effets modulés dans le temps.
[4] Maison des Lanceurs d’alerte, tiers intervenant dans la procédure.
[5] Communiqué de presse du 14 février 2023.
[6] Article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite « Sapin II », dont la rédaction est issue de l’article 1er de la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte :
« I.-Un lanceur d’alerte est une personne physique qui signale ou divulgue, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, des informations portant sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l’intérêt général, une violation ou une tentative de dissimulation d’une violation d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, du droit de l’Union européenne, de la loi ou du règlement. Lorsque les informations n’ont pas été obtenues dans le cadre des activités professionnelles mentionnées au I de l’article 8, le lanceur d’alerte doit en avoir eu personnellement connaissance.
II.-Les faits, informations et documents, quel que soit leur forme ou leur support, dont la révélation ou la divulgation est interdite par les dispositions relatives au secret de la défense nationale, au secret médical, au secret des délibérations judiciaires, au secret de l’enquête ou de l’instruction judiciaires ou au secret professionnel de l’avocat sont exclus du régime de l’alerte défini au présent chapitre.
III.-Lorsque sont réunies les conditions d’application d’un dispositif spécifique de signalement de violations et de protection de l’auteur du signalement prévu par la loi ou le règlement ou par un acte de l’Union européenne mentionné dans la partie II de l’annexe à la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union, le présent chapitre ne s’applique pas.
Sous réserve de l’article L. 861-3 du code de la sécurité intérieure, lorsqu’une ou plusieurs des mesures prévues aux articles 10-1,12 et 12-1 de la présente loi sont plus favorables à l’auteur du signalement que celles prévues par un dispositif spécifique mentionné au premier alinéa du présent III, ces mesures s’appliquent. Sous la même réserve, à défaut de mesure équivalente prévue par un tel dispositif spécifique, les articles 13 et 13-1 sont applicables. ».