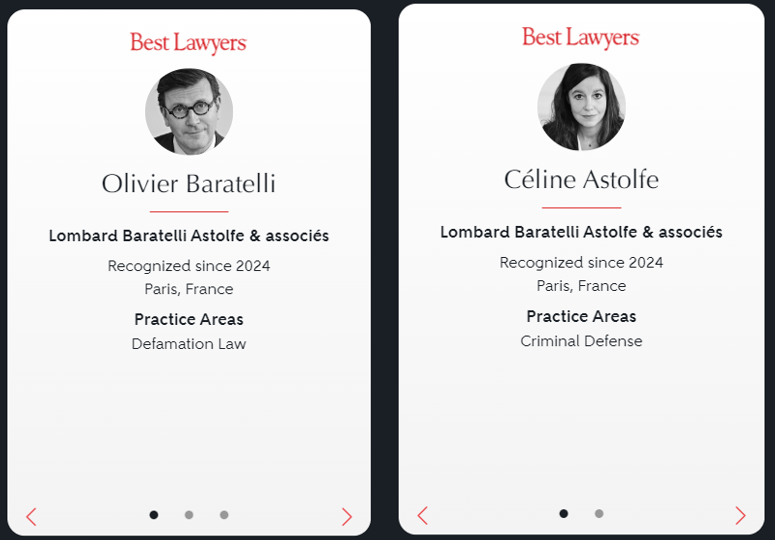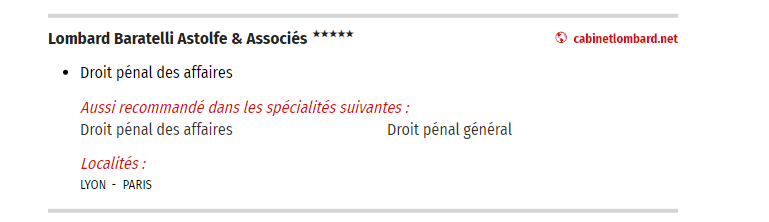Le droit de la presse veille à ce qu’il soit toujours possible de déterminer une personne responsable pénalement pour les infractions commises sur un média ou un réseau social.
C’est ainsi que l’article 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle dispose que :
« Au cas où l’une des infractions prévues par le chapitre IV de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est commise par un moyen de communication au public par voie électronique, le directeur de la publication ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article 93-2 de la présente loi, le codirecteur de la publication sera poursuivi comme auteur principal, lorsque le message incriminé a fait l’objet d’une fixation préalable à sa communication au public.
A défaut, l’auteur, et à défaut de l’auteur, le producteur sera poursuivi comme auteur principal. »
- la notion de producteur et son régime de responsabilité pénale …
En ce sens, dispose de la qualité de « producteur » au sens de l’article 93-3 précité, le titulaire d’une page d’un réseau social sur laquelle des commentaires peuvent être publiés.
La Cour de cassation, tirant les conséquences d’une décision rendue par le Conseil constitutionnel[1] , a défini dans un arrêt du 31 janvier 2012[2] le régime juridique de la responsabilité pénale du producteur :
« Il se déduit de l’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 modifiée, interprété selon la réserve émise par le Conseil constitutionnel dans sa décision QPC No 2011-64 du 16 septembre 2011, que la responsabilité pénale du producteur d’un site de communication en ligne, mettant à la disposition du public des messages adressés par des internautes, n’est engagée, à raison du contenu de ces messages, que s’il est établi qu’il en avait connaissance avant leur mise en ligne ou que, dans le cas contraire, il s’est abstenu d’agir promptement pour les retirer dès le moment où il en a eu connaissance.
Encourt dès lors l’annulation l’arrêt qui déclare le créateur d’un forum de discussion en ligne coupable de diffamation, à raison du message émis sur cet espace de contributions personnelles par un utilisateur du site, sans rechercher si, en sa qualité de producteur au sens du texte susvisé, il avait eu connaissance, préalablement à sa mise en ligne, du contenu de ce message ou si, dans le cas contraire, il s’était abstenu d’agir avec promptitude pour le retirer dès qu’il en avait eu connaissance[3] ; (…) »
- … appliqués à un homme politique n’ayant pas promptement retiré des commentaires illicites publiés sur sa page Facebook
Dans son arrêt de Grande Chambre du 15 mai 2023[4], la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) s’est prononcée sur la question de savoir si la condamnation, en sa qualité de « producteur », d’un responsable politique pour ne pas avoir promptement supprimé des commentaires à caractère islamophobe, publiés, en période de campagne électorale, sur le « mur » de sa page Facebook, était ou non contraire à l’article 10 de la Convention.
Comme elle en a désormais l’habitude, et ainsi qu’elle en avait fait de même dans son arrêt de chambre rendu le 2 septembre 2021, la CEDH s’est demandée si l’ingérence qu’a constitué la condamnation pénale du requérant dans l’exercice de son droit à la liberté d’expression est ou non conforme à la Convention.
Plus précisément, la Cour rappelle que pour être conforme une telle « ingérence doit être « prévue par la loi », poursuivre un ou plusieurs buts légitimes au sens du paragraphe 2 de l’article 10, et être « nécessaire dans une société démocratique »[5].
Aussi, l’existence d’un ou plusieurs buts légitimes ne faisant pas débat pour la Cour[6], ce sont davantage, d’abord, la question de savoir si l’ingérence était « prévue par la loi » au sens de la jurisprudence de la CEDH, c’est-à-dire si elle était suffisamment « prévisible », ensuite, celle de la nécessité d’une telle ingérence dans une société démocratique, qui se posaient en l’espèce.
- … ne viole pas les dispositions de l’article 10 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales
- une ingérence prévue par la loi :
Au soutien de la requête était notamment avancé le fait que le requérant a été « condamné en sa qualité de « producteur », au sens du droit français, sans qu’aucune notification lui demandant de retirer les propos litigieux ne lui ait été adressée. Il soutient que sa connaissance tant des commentaires que de leur caractère illicite n’a pas été démontrée. »[7].
Le requérant soutenait également, outre le fait que la notion de « producteur » n’était pas définie par la loi s’agissant des réseaux sociaux, que :
« l’application de l’article 93-3 de la loi no 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle et sa condamnation en qualité de producteur n’étaient pas prévisibles et que le principe de sécurité juridique imposerait une mise en demeure préalable au producteur »[8]
La Cour n’a pas suivi la thèse du requérant et ce malgré le caractère inédit de la question de la responsabilité « du titulaire d’un compte Facebook, en l’espèce un homme politique en campagne électorale, en raison de propos diffusés sur son mur, en particulier dans un contexte politique et en période électorale » ; lequel caractère ne constituant, en soi, pas « une atteinte aux exigences d’accessibilité et de prévisibilité de la loi ».
En effet, le cadre juridique interne défini tant par la Cour de Cassation que par le Conseil constitutionnel (cf. supra) est suffisamment précis pour que le régime juridique de partage de responsabilité institué par loi, et interprété par les juridictions internes, puisse ne pas être considéré comme « arbitraire ou manifestement déraisonnable ».
C’est la raison pour laquelle la Grande Chambre juge que « l’article 93-3 de la loi no 82-652 du 29 juillet 1982 était formulé avec une précision suffisante, au sens de l’article 10 de la Convention, pour permettre au requérant de régler sa conduite dans les circonstances de l’espèce. ».
D’ailleurs, la Cour relève que « le requérant, alors qu’il était assisté d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, n’a pas soulevé cette question dans le cadre de son pourvoi en cassation, ce qui révèle qu’il n’entendait pas contester devant les juges internes la qualité du fondement légal des poursuites dont il faisait l’objet. »[9].
- une ingérence nécessaire dans une société démocratique :
Pour répondre à cette question, la Grande Chambre examine l’affaire au regard des principes dégagés dans sa décision « Delfi AS c. Estonie » [10] :
Le contexte des commentaires : sur ce point, même si « Dans le contexte d’une compétition électorale, la vivacité des propos est plus tolérable qu’en d’autres circonstances (Desjardin c. France, n° 22567/03, 48, 22 novembre 2007, et Brasilier c. France, n° 71343/01, § 42, 11 avril 2006) », la Cour relève que « L’impact d’un discours raciste et xénophobe devient alors plus grand et plus dommageable »[11].
La Cour s’attache donc à examiner « le contenu des propos litigieux, à la lumière notamment des motifs retenus par les juridictions internes » et, alors qu’ « il n’existe pas de définition universelle du « discours de haine » », et estime que « les commentaires litigieux publiés par S.B. et L.R. sur le mur du compte Facebook du requérant étaient clairement illicites » ; peu important que « ces commentaires correspondent, comme le prétend le requérant, au programme politique de son parti »[12].
Le contexte politique et la responsabilité particulière du requérant en raison de propos publiés par des tiers : dans la mesure où, à la différence de l’arrêt Delfi précité, le compte Facebook du requérant « ne saurait être assimilé à un « grand portail d’actualités sur Internet exploité à titre professionnel et à des fins commerciales »», la Cour considère que :
« les spécificités de la présente affaire conduisent la Cour à aborder cette question au regard des « devoirs et responsabilités », au sens de l’article 10 § 2 de la Convention, qui incombent aux personnalités politiques lorsqu’elles décident d’utiliser les réseaux sociaux à des fins politiques, notamment à des fins électorales, en ouvrant des forums accessibles au public sur Internet afin de recueillir leurs réactions et leurs commentaires. »[13]
Or, même si le requérant ne disposait pas d’un système de filtrage des commentaires publiés sur son mur, la CEDH considère que cela ne saurait l’exonérer de toute responsabilité :
« le fait de décharger les producteurs de toute responsabilité risquerait de faciliter ou d’encourager les abus et des dérives, qu’il s’agisse des discours de haine et des appels à la violence, mais également des manipulations, des mensonges ou encore de la désinformation. »[14]
Aussi, « tout en rappelant avoir conclu que le contenu des commentaires publiés sur le mur du compte Facebook du requérant était clairement illicite », et après avoir précisé qu’au regard du « contexte local difficile » et compte tenu de leur « dimension politique avérée », les juridictions internes étaient les mieux placées pour apprécier les faits, la Grande Chambre :
« souscrit ainsi pleinement à la conclusion de la chambre selon laquelle le langage employé en l’espèce incitait clairement à l’incitation à la haine et à la violence à l’égard d’une personne à raison de son appartenance à une religion, ce qui ne peut être camouflé ou minimisé par le contexte électoral ou la volonté d’évoquer des problèmes locaux[15] »
Les mesures appliquées par le requérant : si la Cour note « qu’aucune disposition n’imposait la mise en place d’un filtrage préalable des messages et qu’il n’existait pas de possibilité pratique d’opérer une modération a priori sur Facebook», il demeure que le requérant – même si ce choix n’était pas en lui-même critiquable – ne pouvait ignorer que rendre publics les commentaires publiés sur son mur, au regard du contexte local tendu, était « lourd de conséquence ».
Il ne saurait, en effet, exister un droit à l’impunité.
Aussi, quand bien même le requérant a appelé ses « amis » à ne pas tenir de propos illicites sur sa page, la Cour relève qu’il s’est abstenu de supprimer les commentaires litigieux alors même que leur nombre (15), déterminé devant la Cour, n’empêchait pas le requérant d’exercer une surveillance ou un contrôle effectif de ces écrits.
La Grande Chambre :
« fait d’ailleurs sien le constat de la chambre selon lequel le requérant a publié ce message d’avertissement sans supprimer les commentaires litigieux ni même, surtout, prendre la peine de vérifier ou de faire vérifier le contenu des commentaires alors accessibles au public (voir le paragraphe 97 de l’arrêt de la chambre). L’absence d’un tel contrôle minimal apparaît d’autant plus inexplicable que, dès le lendemain, le requérant avait été alerté par S.B. de l’intervention de Leila T. (paragraphe 22 ci-dessus) et qu’il était ainsi effectivement informé des problèmes susceptibles d’être soulevés par les autres commentaires. »
La Cour estime donc pertinent d’opérer ici un contrôle de proportionnalité prenant en considération le « niveau de responsabilité susceptible de peser sur la personne visée » ; un particulier ayant « moins d’obligations qu’une personne ayant un mandat d’élu local et candidate à de telles fonctions, laquelle aura à son tour moins d’impératifs qu’une personnalité politique d’envergure nationale, pour qui les exigences seront nécessairement plus importantes, en raison tant du poids et de la portée de ses paroles que de sa capacité à accéder aux ressources adaptées, permettant d’intervenir efficacement sur les plateformes de médias sociaux (voir, mutatis mutandis, Mesić c. Croatie, no 19362/18, § 104, 5 mai 2022, et Melike, précitée, § 51). »
La possibilité que les auteurs des commentaires soient tenus pour responsables plutôt que le requérant :
Sur ce point, la Cour note que les faits reprochés aux auteurs des propos étaient distincts de ceux pour lesquels le requérant était poursuivi. La Grande Chambre adopte par ailleurs le raisonnement de l’arrêt de chambre aux termes duquel il avait été conclu que le requérant n’a « pas été poursuivi en lieu et place de S.B. et L.R., également condamnés par ailleurs »[16].
Les conséquences de la procédure interne pour le requérant : alors que la Cour, d’une part, admet qu’une condamnation pénale peut avoir des effets négatifs sur la liberté d’expression dès lors qu’elle est susceptible d’en dissuader l’exercice, d’autre part, note l’existence d’un mouvement de dépénalisation de la diffamation dans certains Etats, la CEDH constate toutefois qu’un tel mouvement ne concerne pas les discours de haine. Une condamnation n’entraine d’ailleurs pas nécessairement de conséquences autres que les peines prononcées. Tel est bien le cas ici pour le requérant d’après la Cour :
« Or, en l’espèce, la Cour relève qu’à l’époque des faits le requérant encourait jusqu’à un an d’emprisonnement et 45 000 EUR d’amende (paragraphe 35 ci-dessus). Il a cependant été condamné au seul paiement d’une amende de 4 000 EUR en première instance, montant ramené à 3 000 EUR par la cour d’appel, ainsi qu’au versement d’une somme de 1 000 EUR à Leila T. au titre de ses frais et dépens (paragraphe 30 ci‑dessus). En outre, comme la chambre l’a observé à juste titre, cette condamnation n’a pas entraîné d’autres conséquences pour le requérant (voir le paragraphe 103 de son arrêt). La Cour note en particulier que le requérant n’allègue pas avoir dû changer de comportement par la suite ni que sa condamnation eût un quelconque effet dissuasif sur l’usage de son droit à la liberté d’expression, ou encore des conséquences négatives pour son parcours politique ultérieur et dans ses relations avec les électeurs. Au demeurant, elle constate que sa condamnation par le tribunal correctionnel, confirmée par la cour d’appel de Nîmes le 18 octobre 2013, ne l’a pas empêché d’être élu maire de la ville de Beaucaire en 2014 et de continuer à exercer des responsabilités au nom de son parti politique (voir paragraphe 13 ci-dessus). »
*
L’examen in concreto de l’affaire a permis à la Cour de juger que les condamnations prononcées par les juridictions internes constituent une ingérence nécessaire dans une société démocratique et de conclure à l’absence de violation de l’article 10.
Cette décision, déjà intéressante par la qualité de responsable politique du requérant, l’est également par le signal qu’elle envoie aux auteurs de discours de haine que les droits garantis par la Convention ne sauraient protéger d’éventuelles condamnations pénales.
On soulignera également l’importance, dans cette analyse in concreto de la nécessité de l’ingérence, de l’appréciation portée par les juges nationaux sur les faits. Ainsi que le rappelle la Cour :
« elle n’a point pour tâche, lorsqu’elle exerce son contrôle, de se substituer aux juridictions internes compétentes, qui jouissent au demeurant d’une marge d’appréciation, à laquelle le préambule de la Convention se réfère expressément à la suite de l’entrée en vigueur du Protocole no 15 le 1er août 2021, mais de vérifier la compatibilité avec les exigences de l’article 10 des décisions qu’elles ont rendues en vertu de leur pouvoir d’appréciation, et ce en appréciant l’ingérence litigieuse à la lumière de l’ensemble de l’affaire. »[17]
[1] Cons. Const., 16 septembre 2011, n° 2011-164 QPC.
[2] Cass. Crim., 31 janvier 20212, n° 10-80.010 ; voir également Cass. Crim., 30 octobre 2012, n° 10-88.825).
[3] Souligné par nos soins.
[4] CEDH, Grande Chambre, 15 mai 2023, Sanchez c. France, n° 45581/15.
[5] §123.
[6] §143.
[7] § 88.
[8] §132.
[9] §141.
[10] N° 64569/09, CEDH 2015.
[11] §153.
[12] §178.
[13] §180.
[14] §185.
[15] Mis en gras et souligné par nos soins.
[16] §203.
[17] §198.